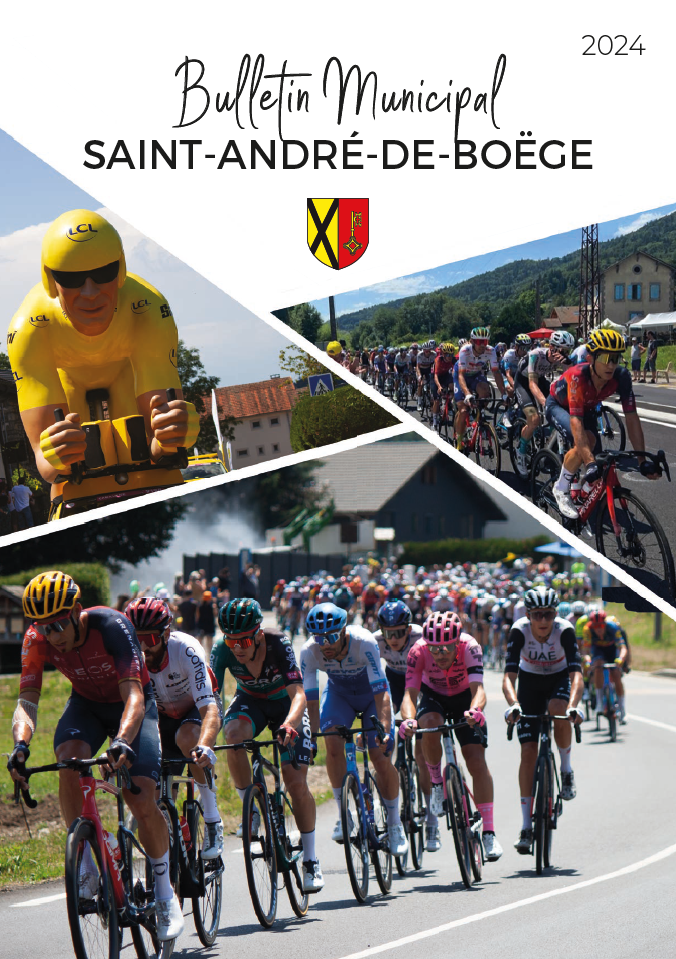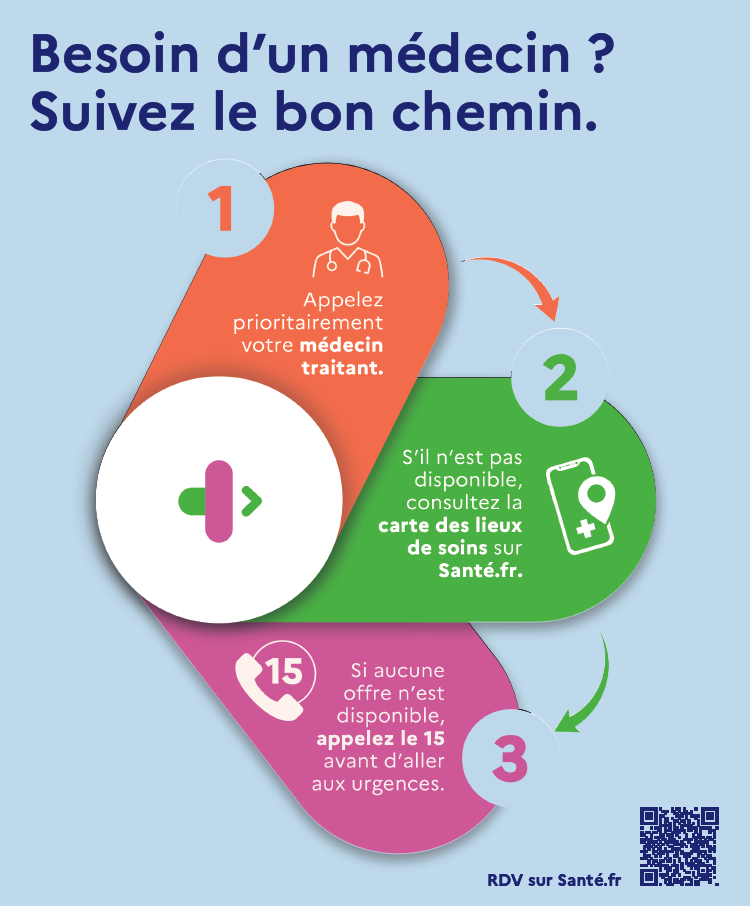Saint-André d’autrefois
A contempler aujourd’hui le village de St-André qui éparpille ses jolies maisons en petits hameaux disséminés de chaque côté des rives de la Menoge, on ne peut qu’admirer sa beauté parmi la verdure des champs, des prairies et des bois. Même quand l’hiver le saupoudre de givre ou de neige, étouffant les bruits, imprégnant de silence, c’est encore un lieu de rêve où il fait bon vivre.
Après l’exode rural, surtout après les années 50, les fermes s’abandonnaient, le pays se dépeuplait jusqu’à ce que, peu à peu, des personnes venues d’ailleurs, rachètent les anciennes bâtisses, les « retapent », les fleurissent. D’autres construisirent de pimpantes villas. On s’adapte plus ou moins bien, certains vivant pleinement cette situation, l’adoptant, s’y intégrant et la faisant vivre. D’autres auraient voulu (comme l’humoriste) transporter à la campagne leurs impressions de la ville, regrettant le fumier un peu trop proche, le son des cloches des vaches en pâture, ou souhaiter retrouver les prairies tondues comme un gazon anglais et chaque endroit « propre en ordre comme chez eux » – c’est bien regrettable !
Mais en fait qu’était le village, voilà quelques décennies ? Un chef-lieu avec, près de l’église et du presbytère, une ferme, un café-épicerie, quelques maisons. Les habitants se construisaient leurs bâtisses, souvent modestes, auprès de leurs champs. Aussi étaient-elles disséminées en petits hameaux jusque sous la forêt. Ces lieux-dits prenaient la dénomination de l’endroit (Le Plâne, La Crosse, La Molière, etc.) ou du nom de la famille (chez les Reybaz, chez les Ruhin, chez Sommelier, etc). Bien souvent, ils bâtissaient eux-mêmes, taillaient les pierres qu’ils avaient charroyées, montaient le sable depuis la Menoge, fabriquaient la chaux en brûlant du calcaire, apprêtaient le bois pour la charpente et les façades des granges (bois coupé à la lune dure d’août qui lui assurait longue conservation). Ces habitations comprenaient habituellement une cuisine avec, si possible la cheminée et le four à pain, le « pèle », la deuxième pièce où l’on se tenait par grand froid autour d’un « quatre marmites* ». Au dessus, deux chambres. A côté de l’habitation, l’étable et, sous le toit, la grange où ranger le foin. Un à-côté servait d’abri et de remise pour abriter l’outillage (chars, etc) ; séparé de la maison d’habitation, le grenier de bois pour recevoir la récolte de la moisson (blé, avoine, orge ou seigle) dans des « enchatres* » et quelquefois, le porc fumé (quand on en avait). Contre une pente, on creusait une « cave », où s’alignaient quelques tonneaux pour le cidre, les bonbonnes pour l’eau de vie, et qui servait aussi de chambre froide. Près de la demeure, un bassin alimenté par une source ou par un puits. Par contre, quelques uns étaient plus mal lotis. Les récits parlent encore de ces fileuses logeant dans les grottes des Barmes.
Selon la fortune de chacun, on élevait quelques vaches ou parfois simplement des chèvres. Mais toujours des lapins, des poules courant autour de la maison sous l’œil intéressé des milans, des buses et des renards. La basse-cour était nourrie à peu de frais des restes du ménage ou de la récolte, permettant une amélioration du menu quotidien, ou une vente sur le marché de leur viande et des œufs. Avant 1914, la région n’était-elle pas réputée pour ses excellentes volailles et ses chapons ?
La plupart des exploitations étaient petites, pas un pouce de terrain n’était négligé, même les versants aujourd’hui boisés. On labourait chaque parcelle, d’année en année pour renouveler le fourrage. Un peu de blé (ou de seigle) pour la consommation familiale, de l’avoine pour les bêtes de trait, aussi des raves, des choux, des haricots récoltés en grains et l’indispensable pomme de terre qui composait bien des menus, surtout la soupe, pour certains trois fois par jour.
Le chanvre aussi était cultivé sur de longues « rames » pour confectionner, après rouissage, draps et chemises inusables.
L’idéal était de vivre en autarcie, n’acheter aux épiceries situées près des débits de boissons que le strict nécessaire qu’on ne produisait pas (sel, sucre, pâtes, tabac aussi, et rarement une friandise pour les enfants).
Le bois de chauffage était précieux. Les branches ou les écorces des arbres abattus étaient ramassées minutieusement. Un ancien racontait que le garde des Eaux et Forêts surveillait son père qu’il soupçonnait d’avoir coupé des noisetiers pour chauffer sa soupe ! !
Les travaux des champs et des bois, un confort relatif et le souci quotidien pour beaucoup de nourrir leur nombreuse famille faisaient de tous ces habitants des montagnards solides, un peu rudes, au caractère fortement trempé, « la tête un peu près du chapeau ». Les plus faibles étaient éliminés en bas âge, à lire les archives des décès.
Il fallait être robuste pour entreprendre, dès les premiers jours de printemps, dès la fonte de la neige, les labours à 3 ou 4 chevaux ou mulets, sur des versants pentus. Parfois, la motte de terre du sillon était repoussée à la main. Les bêtes d’attelage se prêtaient de voisin à voisin ou dans la parenté.
Dans les terres grasses, compactes, avant de pouvoir herser pour semer, les mottes devaient être piochées à la houe. On traînait sur les labours, pour les ameublir, soit des épines, soit cet appareil de bois lourd « le cacheu », un genre de traîneau lourd à tirer, ce qui fit dire à un passant regardant un paysan en train de l’utiliser « Monseigneur Jésus Christ a porté sa croix, toi tu la traînes ».
Manuellement aussi les fenaisons avec le fauchage à la faux, puis toute la manipulation jusqu’à la grange à la fourche : tourner, défaire, brasser, entasser, charger et râteler avec soin (pas une bûche de foin n’était abandonnée) et cela dans la poussière, la sueur, sous le grand soleil.
Les récoltes se disputaient par temps chaud aux orages menaçants, à la pluie. La campagne, à cette période, était particulièrement animée. Chaque famille oeuvrait sur sa parcelle ; même les enfants étaient occupés, l’un à ramasser les « ratelins », l’autre avec une branche feuillue, à chasser les taons des chevaux, tandis que les grandes personnes entassaient en fourchées, puis chargeaient sur les chars. Les plus démunis utilisaient de grands draps, gonflés de la récolte et qu’ils portaient sur le dos jusqu’à la maison. Qu’un verre de cidre mis au frais était agréable dans ces temps là !
On recommençait avec les moissons, puis, si le temps le permettait, les regains. Les céréales se battaient au fléau ! Par temps froid, l’automne étant venu, c’était la récolte des fruits (pommes et poires) pour le cidre familial. L’hiver apportait son lot de travaux (transport, oh combien dangereux !, du foin depuis les hauteurs sur des luges, transport de bois).
La vie étant si rude, rares étaient ceux qui roulaient sur l’or. Pour subsister, les plus courageux, ou les plus démunis, louaient leurs bras, certains travaillant dans le pays, d’autres s’en allaient jusque dans le Mandement de Genève, en s’embauchant au Molard, ou profitaient des « effeuilles* » ou des vendanges pour rapporter quelques sous à la maison. Qui pouvait prenait une coupe de bois, ou une descente de billons en établissant une « rise* », cela durant la période la plus froide de l’année.
Quelques uns restaient près de chez eux et fabriquaient des échelles, des seaux de bois. Cet autre allait tailler dans la roche des meules et des bassins de molasse ne faisant éclater la pierre avec des coins de bois imprégnés d’eau. Il y faisait si froid à manipuler les outils de fer qu’il devait emporter des braises rouges dans une marmite pour s’y réchauffer les doigts. D’autres tressaient des hottes, des paniers d’osier ou de « ouable » (clématite sauvage).
Permettez une digression : un voisin m’a raconté comment il préparait cette dernière : après avoir choisi et coupé les longueurs appropriées de ces plantes grimpantes, il les laissait sécher pendues à l’ombre. Durant l’hiver, il les faisait « cuire » à l’eau bouillante, fenêtres grandes ouvertes, car il se dégageait de la cuisson un gaz toxique qui prenait à la gorge et faisait pleurer en piquant les yeux. Quand les baguettes étaient sèches, il les passait sur le dossier d’une chaise pour en détacher l’écorce et son matériau de « tressage » était prêt, pratiquement imputrescible.
Parlons aussi de ceux qui braconnaient un peu, dans la rivière les truites, ailleurs un lièvre par ci, un geai par là ou des grives. A propos de celles-ci, la région dans ce temps-là était célèbre pour ses chasses aux grives que l’on portait en quantité au marché d’Annemasse. Il y avait aussi les plus hardis qui allaient livrer leur marchandise (légumes, bois en billons ou en bûches, fruits sauvages et champignons) jusqu’à Genève. Ils se retrouvaient certains jours en petites caravanes qui s’entraidaient aux passages difficiles, tant pour l’état des chemins que pour les mauvaises rencontres. Si l’on remonte au début du siècle, les plus importants vendeurs se faisaient payer en or, n’ayant qu’une confiance limitée en la monnaie helvétique – les temps ont bien changés -.
Puisque nous côtoyons la frontière, disons un mot en passant des aventureux qui tâchaient de gagner quelque argent en important, en contrebande, des produits d’épicerie ou du tabac plus avantageux l’autre côté du Foron que près de la Menoge. Trafic assez profitable jusqu’au jour où, par dénonciation jalouse ou malchance, le contrebandier se faisait « pincer ».
Souvent, à côté de la maison, sous une remise, dans une chambre inhabitée, un banc de menuisier permettait de faire les réparations de meubles ou d’objets de bois. Certains, avec un « banc d’âne » et les outils appropriés, taillaient les râteaux ou le bois des galoches. C’était cela la campagne : être capable, sans s’adresser à un spécialiste, de faire face à un inconvénient, une rupture de harnais, une détérioration accidentelle sur un char, un tombereau, le plus rapidement possible.
On trouvait quand même quelques artisans qui passaient plus de temps à leur métier de menuisier ou de charron qu’à celui de paysan qu’ils demeuraient. Des maréchaux-ferrants, forgerons (certains spécialistes taillandiers) exerçaient leur savoir-faire dans divers lieux de la commune. Pour les aborder en espérant leur proposer un travail, le client devait jouer de toute l’astuce nécessaire pour trouver le bon moment qui n’ôterait pas les artisans à leur fenaison ou de l’arrachage des pommes de terre. Puis, sans en avoir l’air, on discutait prix et chacun s’accordait pour une période précise, qui, dans la réalisation, se montrait incertaine.
Pour aider aux durs travaux de l’exploitation ou du débardage des bois, les plus nantis possédaient un cheval ou un mulet, parfois un âne. L’achat se réalisait à la foire de Fillinges ou de Bons et comme trop souvent, l’acheteur avait à compter au plus juste pour le prix, il ramenait à son écurie une bête soit disant franche et sage, mais qui se révélait, après quelques jours, avec son caractère un peu difficile, à tel point, qu’on s’y mettait à trois pour l’atteler, cris et injures fusant à haute voix.
Bien sûr, il y avait les plus habiles, les plus chanceux, les plus travailleurs, qui finissaient par agrandir leurs parcelles de terre ou de bois. Mais la plupart trimaient pour joindre les deux bouts, quand ils y arrivaient.
Ces villageois savaient malgré tout, vivre de bons moments : la présence aux marchés et aux foires était indispensable et les jours de ces manifestations, de longues files de gens se dirigeaient vers le chef-lieu, qui à pied, chargé de hotte ou de panier pour y porter à vendre du beurre, de la tomme ou des œufs, qui, si la situation le permettait, en voiture à cheval, trottinant tranquillement à l’aller, mais souvent, au retour, essayant de galoper nerveusement, excité par l’attente trop longue loin de l’écurie.
Les jours de fêtes permettaient de se retrouver à l’église, ou au café et la communauté se recréait.
Ces rencontres permettaient de discuter ferme, de l’avance des récoltes, de la famille, du prix des bêtes, évidemment tout en patois, comme à la maison d’ailleurs, un dialecte qu’on devait apprendre « avec les yeux » tellement il était fait d’images vivantes, mais que l’effort des commis de la IIIème République, exécutant à la perfection les directives émanant d’étroitesse d’esprit et de dirigisme, ont fini par tuer.
Les pèlerinages attiraient une partie notable de la population, tel celui de Planet auprès de la Chapelle édifiée par les bénévoles du lieu (qui avaient dû porter à dos le ciment et le sable nécessaires) pour réclamer la protection céleste sur les récoltes. Autrefois, on sonnait aussi la cloche de l’église pour éloigner les orages.
En dehors de la période de gros travaux, les amis et voisins se réunissaient le soir. Ainsi à l’occasion du broyage et pressage des fruits pour le cidre, les copains se retrouvaient, à la lueur d’un falot à pétrole, près de la « conche* » autour de laquelle le cheval, ou le mulet tournait, entraînant le « mau* », la meule de pierre écrasant les pommes et les poires. D’une main rapide, une personne suivait le mouvement rotatif, ramenant la pâte au centre du bassin. Les autres s’aidaient à puiser pour remplir la « fétière* » du pressoir et à actionner le treuil utilisé pour faire descendre le long de la vis, les pièces de bois appuyant fortement sur les fruits broyés. Le moût, très doux, coulait, on y goûtait, on appréciait, on plaisantait ; tout se passait dans la bonne humeur. Pendant l’attente entre chaque opération qui devait se dérouler calmement et tandis que le cheval se reposait dégustant un peu de pommes broyées, les jeux s’organisaient et comme l’ambiance était bonne, garçons et filles dansaient au son d’un violon, d’un accordéon et d’une batterie improvisée. Quand le travail se terminait, le propriétaire invitait à partager un petit repas. La patronne cuisait une « épougne* », on se partageait une tomme, un saucisson parfois, arrosés de cidre frais et d’un verre de « goutte ». Il est arrivé qu’un facétieux entra subrepticement dans la cuisine de la maison tandis que tout le monde, autour du pressoir, était occupé à travailler ou à s’amuser, récupérant prestement la farine, les œufs prévus pour l’en-cas et les subtilisait. Au moment où le maître des lieux invitait son monde pour se restaurer, les ingrédients du repas étaient introuvables. Aux invités de se récrier : « tu nous fais travailler et au moment de manger, tu n’as rien de prévu. On peut avoir confiance en toi !». Le malheureux n’y comprend goutte, tâche d’arranger la situation, accuse sa femme de négligence. Puis les joyeux compères auteurs de la farce, s’en vont en haussant les épaules, pour se retrouver chez l’un d’entre eux et déguster le petit repas.
Malgré la dureté des temps, la plupart des habitants du village étaient joueurs, farceurs même, avec, évidemment, les éternels souffre-douleur. Les veillées autour du foyer étaient aussi, durant la morte-saison, l’occasion de se retrouver pour partager la « brosolée* » de châtaignes ou les rissoles au temps de Noël, et surtout se raconter des histoires.
Avec l’ambiance d’une salle mal éclairée par une lampe à pétrole dont les flammes projetaient contre les murs des ombres impressionnantes, avec le vent qui ronflait dans la cheminée, le décor était planté pour écouter, avec un peu d’angoisse, les histoires des revenants, des « sarvants* », de maléfices. Un grand père racontait qu’un de ses voisins avait trouvé, un soir, ses vaches attachées ensemble, ou son cheval avec la queue tressée. C’est qu’on croyait aux pouvoirs occultes de certains personnages, un peu troubles, inquiétants, qui connaissaient la « physique* ». Et les contes reprenaient, de plus en plus mystérieux, plus troublants, « celui-ci m’a raconté qu’un de ses amis etc. etc…. ».
Pour citer un de ces récits fabuleux, voici celui que j’ai entendu un jour : c’était il y a de ça bien longtemps, près de 100 ans. Il y avait eu des élections municipales avec une virulente opposition gauche-droite, comme heureusement, on n’en connaît plus. Contrairement aux prévisions, la droite l’emporta au grand scandale des battus. En consultant les listes des votants, l’un des protagonistes évincés s’aperçut, à son étonnement, qu’un sien parent était venu de loin pour accomplir son devoir de citoyen. Il protesta : « jamais celui-ci ne serait venu au village sans passer à la maison et y prendre son repas ». Et de fil en aiguille, après enquête, le scrutin fut jugé falsifié et annulé. On recommença les opérations de vote qui, après grande surveillance, donna la majorité à la gauche. Les jours passèrent et l’intervenant qui fit découvrir la tromperie électorale commença à s’inquiéter. En effet, une de ses génisses, la plus belle évidemment, présentait des singuliers symptômes. Le matin, il la trouvait étendue de tout son long, s’étranglant avec son lien, incapable de se lever. Affolé, il la prit à bras le corps et sortit de l’étable. A l’air libre, la bête se sentait mieux, mais sa cuisse qui touchait le sol de l’étable était une vraie plaie grouillante de vers. Il la soigna, lava la plaie et rentra son animal qui, aussitôt retomba sur le côté, inanimé. Il comprit qu’un sort lui avait été jeté. Sans hésiter, ils prit son chapeau neuf, attela le cheval et partit « consulter ». En entendant le récit qu’il lui fit, son interlocuteur, un de ces personnages qui connaissaient formules et gestes pour guérir mais aussi pour faire le mal, lui répondit que celui qui lui avait jeté un sort était bien plus puissant que lui-même et qu’il devait consulter plutôt un tel, d’un autre village, car ce dernier était vraiment exceptionnel. A sa rencontre avec le dit personnage, le subisseur de mauvais sort reçut cette réponse surprenante : « prends un morceau de lard bien gros. Fais le tour de ta maison en t’éloignant progressivement. Dans la première fourmilière que tu trouveras, enterre ton morceau de lard. Les fourmis le dévoreront et celui qui t’a jeté le sort sera obligé de le lever, tellement il éprouvera de souffrance, comme si c’était son corps que les fourmis dévoraient ». Ce qu’il fit. Bientôt sa génisse fut sur pieds, mangeant normalement. Seule lui reste sur le côté comme un dessin sur les poils, à la place de la plaie. L’épouse du paysan lésé, femme très pieuse, voulut porter une offrande pour une messe au curé de la paroisse pour que sa maison soit désenvoûtée. Le curé ne put la recevoir, étant allongé sur son lit, victime d’une crise de goutte ou de rhumatisme si terrible qu’on aurait pu croire que des bêtes le dévoraient tout vivant.
En écoutant ces récits, chacun se remémorait une anecdote, ou une histoire encore plus alarmante, encore plus vraie « on m’a toujours dit que… ». Et quand chacun rentrait chez soi, par des chemins non éclairés, en longeant les haies ou les bois, avec seulement une lampe tempête portée par l’un d’eux, les moins courageux regardaient avec crainte la nuit sombre où les ombres projetées semblaient maléfiques, surtout si quelque oiseau de nuit, intrigué par la flamme vacillante poussait son appel, comme une interrogation. Qu’on se trouvait bien, l’instant d’après, calfeutré dans son lit, encore frémissant des émotions de la soirée.
En dehors de ces moments, des bals étaient organisés, des soirées théâtrales. Parties de quilles figuraient au programme, et le soir, la belotte rassemblait autour des tables de café les amateurs de cartes.
Voici quelques souvenirs d’antan, une évocation trop succincte de la vie des ancêtres du village, conditionnés par les difficultés de l’existence, mais qui nous ont laissé un patrimoine matériel embelli grâce à une situation économique plus florissante et une culture se désagrégeant au fil des jours sous l’influence de la modernité.
Glossaire
Quatre marmites : fourneau de fonte bas avec possibilité d’y cuire 4 marmites à la fois.
Enchatres : coffres de bois à l’intérieur du grenier pour y conserver les céréales.
Effeuilles : action de dépouiller les vignes du feuillage inutile.
Rise : couloir en pente avec parties boisées permettant de faire glisser les billons de bois.
Conche : bassin de pierre pour écraser les fruits.
Mau : meule tournant dans la conche pour écraser les fruits.
Fétière : grande faisselle en bois du pressoir contenant les fruits à écraser.
Epougne : sorte de galette de farine – pain non levé.
Brosolée : châtaignes rôties.
Sarvants : sorte d’esprit facétieux.
Physique : ensemble des connaissances de la sorcellerie.